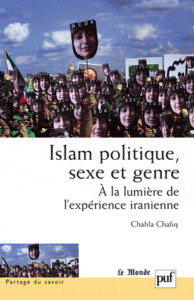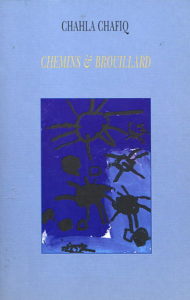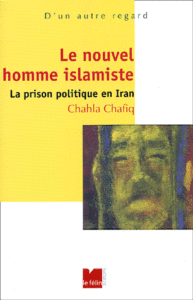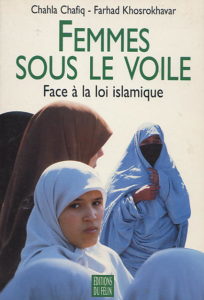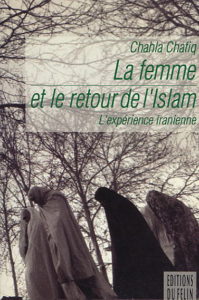Mes langues
Le persan est ma langue maternelle, une langue qui berce une littérature magnifique, qui véhicule une histoire et une expérience vertigineuses. Le français est ma langue d’adoption, ma langue d’exil, qui m’a donné la clé pour entrer dans une autre histoire, une autre littérature et une autre expérience tout aussi fascinantes.
Longtemps, j’ai réservé le français à mes essais et je n’écrivais mes nouvelles qu’en persan. Puis, j’ai dépassé cette frontière pour explorer, dans mes deux langues, tout genre d’écriture.
L’écriture est devenue mon lieu d’existence, hors frontières, pour vivre la liberté.
Mon parcours
C’est en 1981 que la France est devenu mon pays refuge, après deux ans de vie clandestine en Iran commencée à l’arrivée des islamistes au pouvoir, lorsque ces derniers entreprirent la chasse aux opposants pour instaurer un ordre totalitaire au nom de Dieu. A l’époque, je pensais qu’ils ne feraient pas long feu, ces nouveaux détenteurs du pouvoir, tant je trouvais absurdes leurs paroles et leurs projets autour de ce nouvel ordre, porteur de lois et de principes de l’islam, qui allait légitimer les inégalités et les violences de tout genre.
De l’islam, je ne connaissais que les pratiques de ma grand-mère Soraya avec qui j’avais vécu pendant certaines périodes de mon enfance, de mon adolescence et de mes débuts de vie d’adulte. Dans mon enfance, j’adorais faire le ramadan pour me réveiller à l’aube et boire du thé sucré dans la pièce illuminée, envahie par la musique de Samovar, avant de me laisser bercer dans un délicieux sommeil par les douces paroles que ma grand-mère me murmurait à l’oreille dans une langue unique qui articulait le turc et le persan. Quand je me réveillais de nouveau pour aller à l’école, elle me préparait un petit sandwich et des fruits pour mon déjeuner qu’elle me conseillait de ne pas oublier. Je pratiquais, comme elle le disait, un "ramadan spécial enfant" qui me permettait de participer aux cérémonies sans être obligée de jeûner, ce qui aurait été nuisible à ma croissance et à ma vie scolaire.
Je n’avais jamais entendu parler de l’obligation de porter le voile ni d’aucune autre interdiction posée au nom de la religion. Mais, dans les dernières années de la décennie 70, j’ai vu le diktat religieux se répandre largement autour de moi : des étudiantes optaient pour le voile comme symbole d’une identité islamique de résistance ; des hommes, jeunes ou moins jeunes, exhibaient une barbe taillée à l’islamique et m’approchaient dans la rue pour demander pourquoi je ne me voilais pas ; des textes dénonçaient les transgressions des lois religieuses comme causes de tous les malheurs. Puis, j’ai vu apparaître les agents islamistes, organisateurs de manifestations anti-dictatoriales, qui veillaient à la non-mixité des groupes de manifestants et manifestantes. Depuis la France, Khomeiny appelait les femmes iraniennes à porter le foulard durant ces manifestations en signe d’unification du peuple contre le pouvoir dominant. Tous ces éléments éveillaient maintes questions en moi quant à leurs significations et conséquences dans la vie individuelle et sociale. Mais elles étaient vite balayées tant j’étais absorbée par cette grande aventure révolutionnaire qui était en cours. Étudiante en sociologie et active dans un mouvement sympathisant de gauche, je goûtais à l’ivresse de la révolution en rêvant à un avenir de liberté.
J’ai été bien vite rattrapée par l’amère réalité de l’instauration des islamistes au pouvoir qui me conduisit à l’exil politique. J’ai trouvé refuge en France et ai vécu un temps entre parenthèses, envahie, comme disent les chercheurs, par un passé qui ne laissait guère de marge au présent ni à l’avenir. La chambre de bonne où je vivais donnait sur la Seine. Chaque jour, pendant de longs instants, les yeux sur le fleuve, je remontais dans le passé et me retrouvais face aux interrogations sur ce qui m’était arrivé, à moi, à ma génération et à mon pays : comment en étions-nous arrivés là ! Une fois sortie de ce temps entre parenthèses, cette question est devenue le thème de mes travaux, tout d’abord menés dans le cadre de mes études en sociologie que j’ai reprises en France.
Ma connaissance de la langue française, je l’ai acquise en enregistrant les cours de sociologie à la Sorbonne avec un magnétophone et en travaillant pendant des heures d’affilée pour les déchiffrer et les transcrire. L’ambiance des cours où chacun n’était occupé qu’à prendre des notes ne correspondait en rien à l’image que j’en avais : celle d’un lieu de débats et réflexions. Néanmoins, par mes transcriptions, je formulais et reformulais en même temps mes propres interrogations. Je poursuivais mon dialogue intérieur, avec les auteurs des ouvrages que lisais à l’aide d’un dictionnaire, en me baladant dans les rues de Paris dont certaines m’étaient connues pour les avoir parcourues à travers le regard de Victor Hugo, de Balzac, de Sartre, de Camus et d’autres écrivains français traduits en persan. Je me battais ainsi contre le cafard de l’exil et les difficultés d’une vie, marquée par des travaux précaires et le manque de moyens, que je menais avec mes proches dans une autre chambre de bonne un peu plus grande. Là, nous vivions parfois à six ou sept, accueillant périodiquement d’autres réfugiés qui arrivaient d’Iran. Nous menions des discussions passionnées sur les causes de l’arrivée des islamistes en Iran et je poursuivais ces discussions dans les milieux humanistes et féministes que j’avais finis par découvrir et où je nouais des liens avec cette France de liberté que j’avais rencontrée dans mes lectures. Mes questions, mes réflexions, mes sensations, je les couchais sur papier, en deux langues : en persan, j’écrivais des nouvelles où se mêlaient réalité et fiction; en français, j’étudiais l’expérience iranienne en tentant d’aborder les grandes interrogations auxquelles je me confrontais. Mon premier ouvrage s’intitula ainsi La femme et le retour de l’Islam, L’expérience iranienne (Paris : Éd. Le Félin, 1991).
A travers l’écriture, je me construisais en tant qu’être en devenir, en me projetant dans un temps et un espace bouleversés par l’exil et une vie mouvementée qui allait me réserver encore bien des épreuves de deuil que je n’ai pu jusqu’à aujourd’hui partager que par l’écriture de nouvelles. Par la suite, je commençai à travailler, au début des années 1990, dans le domaine de l’immigration et des relations interculturelles. Au fur et à mesure de mes observations et multiples rencontres avec les acteurs sociaux, je découvrais à quel point la condition des femmes se trouvait au centre de l’évolution de la démocratie. Je voyais combien cette question était traversée par les enjeux du retour du religieux dans le politique. Je constatais, avec amertume, que l’islamisme, en développement rapide dans la plupart des pays dits musulmans, allait devenir un sujet de première importance dans la société française, tandis qu’en Iran où il l’avait remporté, le pays était en train de vivre la défaite flagrante du projet social proposé par le régime.
Ces constats motivèrent mes ouvrages Femmes sous le voile, face à Loi islamique (Paris : Ed. Le Félin, 1995, en collaboration avec F. Khosrokhavar) et Le nouvel Homme islamiste - la prison politique en Iran (Paris : Ed. Le Félin, 2002). Dans ces livres, l’analyse de l’expérience iranienne met à jour la nature sexiste et anti-démocratique du projet social islamiste en dépit de ses promesses d’émancipation, de dignité et de justice. Faisant de l’islam la source des lois et des normes, l’islamisme prône en effet l’idéologisation de la religion et mobilise le peuple par référence au sacré. Les autres intégrismes religieux se trouvent renforcés par son avancée. Les femmes qui en sont les premières victimes, sont à l’avant-garde des combats contre les intégrismes.
Voilà un défi de taille que nous devons aussi relever !